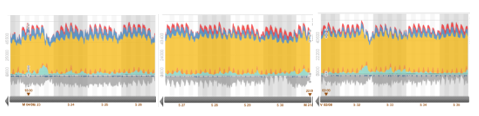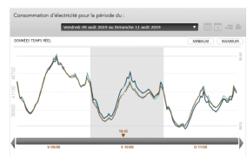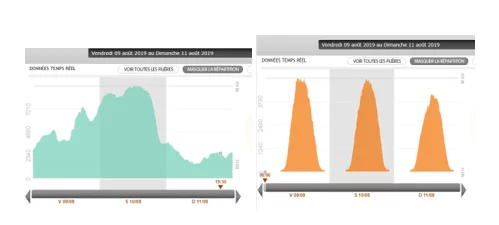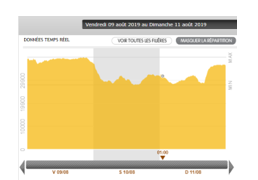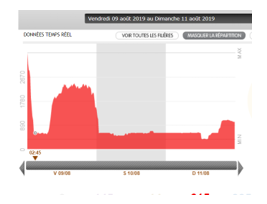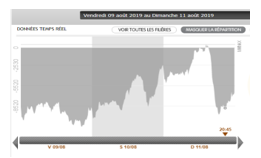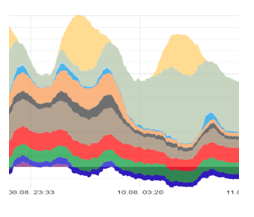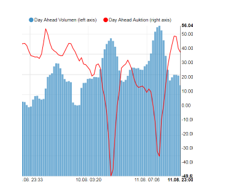Personne n’est en mesure actuellement de prévoir ce qui peut se passer
en cas de problème sur un réseau européen à majorité d’énergies
renouvelables aléatoires et diffuses.
Par Michel Negynas.
Ci-dessous la production française d’électricité par filière en juin,
juillet et août. L’éolien est en bleu clair, le solaire en jaune
foncé : ils sont marginaux. Nous en avons pourtant installé 25 GW,
l’équivalent de 16 EPR !
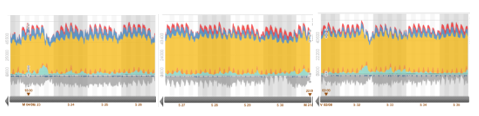
On
voit que les seuls moments ou l’éolien devient un peu significatif,
c’est par des « coups de vent » d’une journée ou deux. Non seulement
cela ne sert à rien, mais cela pourrait poser de gros problèmes si nous
réalisons le programme de développement des énergies renouvelables (ENR)
à 2035.
Que s’est il passé sur le réseau électrique le week-end des 10 et 11
août ? (voir ECO2 mix, l’excellent site de RTE, Réseau de Transport
Electrique, filiale d’EDF)
La puissance appelée par le réseau était de l’ordre de 40 GW, contre
90 GW à la pointe d’hiver. Normal en période de vacances et de chaleur.
Comme d’habitude, la consommation a chuté, de l’ordre de 6 GW de pointe à
pointe entre le vendredi et le samedi :
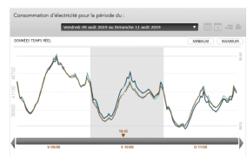
Mais
il se trouve que le vent est passé de 4 à 9 GW entre vendredi midi et
samedi midi… et manque de chance, le Soleil s’y est mis aussi, mais lui,
comme d’habitude : il a pris 5 GW dans la journée de samedi entre 7 h
et midi !
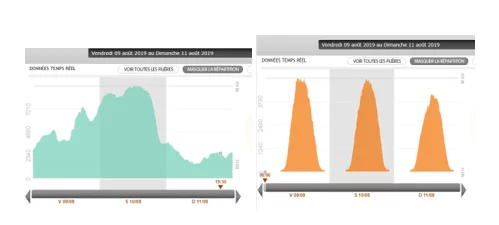
Résumons-nous : la consommation baisse 6 GW, la production aléatoire
augmente de 10 GW… 16 GW de baisse à gérer pour les centrales pilotables
dans la journée de vendredi et samedi…
En 7 heures, le nucléaire a du baisser de 10 GW la nuit de vendredi à
samedi… une gymnastique périlleuse non pas à cause du volume, mais de
la vitesse de la baisse, d’autant qu’il lui a fallu ré‑accélérer dans la
journée de dimanche, où la situation était encore plus critique : en
effet, le vent était retombé à 2 GW, après une chute encore plus brutale
que la montée et le Soleil brillait un peu moins. De 18 h à 22 h 30
samedi, la production des ENR a perdu 5,7 GW, plus d’un GW par heure !
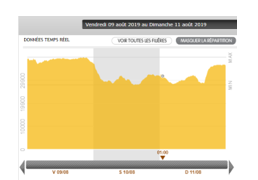
Le gaz s’est adapté lui aussi… cette gymnastique a dû faire dégringoler les rendements… Bonjour le CO2 !
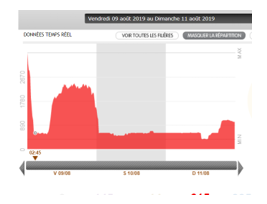
Les
exports ont baissé à 0 GW… très brièvement, le dimanche, sans doute le
signe d’une grande confusion sur les interconnections.
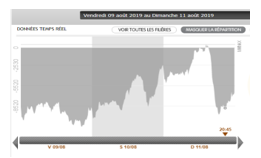
En
Allemagne, c’est la même chose. Le vent est en bleu gris : arrêt du
charbon, et du lignite (gris et noir)… et même, apparemment, de
certaines fermes solaires. Mais les Allemands, comme à leur habitude,
résolvent leur problème en partie par l’export (partie négative de la
courbe). En fait, ils ne conservent de pilotable quasiment que le
nucléaire (en rouge) et la biomasse (en vert). (voir Energy charts du
site de Frauenhofer Institute). Au plus fort du Soleil et du vent, près
des deux tiers du mix était composé de producteurs diffus et volatiles.
Cela
ne marche probablement que parce que l’Allemagne a des interconnections
multiples avec les réseaux de ses voisins, moins ENRisés, qui lui
sauvent la mise pour garder un réseau stable.
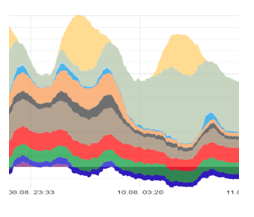
Mais cela ne leur a pas rapporté beaucoup…
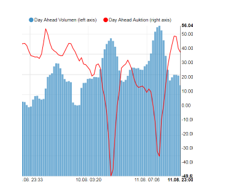
Les prix ont chuté vertigineusement en négatif… Pauvres Allemands qui subventionnent l’électricité de leurs voisins…
Accessoirement, le récent
black out partiel en Angleterre
est survenu le 9 août à 18h… Il y a sans doute de nombreuses causes,
dont la foudre, mais l’une d’elles est certainement la vulnérabilité du
réseau pendant la montée en puissance du vent : l’Angleterre a le plus
grand taux de pénétration de l’éolien en Europe.
Cette situation montre bien la situation dangereuse dans laquelle on
met notre alimentation électrique, (et pas seulement à la pointe
d’hiver, où nous risquons de manquer de capacité) ; or nous n’avons que
25 GW de solaire et d’éolien. Il est question de passer à 90 GW ! Et
nos voisins ont les mêmes objectifs !
Extrapolation à un scénario 2035
Quelques considérations techniques
Peu de gens se rendent compte de la prouesse réalisée par les
ingénieurs concepteurs et gestionnaires du réseau électrique :
équilibrer en permanence, et en tous points, l’offre et la demande. Les
écarts peuvent se traduire par des écarts de la fréquence, de la
tension, des surcharges de ligne, qui en se déconnectant par protection,
mettent tout en danger… Et il y a d’autres paramètres, peu connus du
grand public, qu’il faut absolument contrôler eux aussi, comme la
puissance réactive.
Pourtant, tous les jours, la demande varie fortement entre creux et pointe : c’est gérable car très prévisible.
L’ajout de sources aléatoires diffuses qui de plus ne peuvent jouer
de rôle stabilisateur (une éolienne ou un panneau solaire n’ont pas
d’inertie comme un groupe turboalternateur de 1000 MW…) rend la gestion
difficile. On peut bien sûr ajouter des équipements pour limiter les
risques : c’est coûteux, et source de complexité supplémentaire. Pour
pallier tout cela, certains proposent même de faire tourner à vide de
vieilles centrales à charbon ou nucléaires…
En outre, les variations de la demande, très prévisibles, peuvent
être amplifiées par les variations de l’offre aléatoire, qui ont un
moindre caractère de prévisibilité.
Projetons-nous en 2035 avec un cas de figure comparable à celui
des 10 et 11 août, c’est-à-dire un coup de vent d’un jour, avec zones
orageuses.
Nous aurons 5 fois plus de solaire et trois fois plus d’éolien ;
entre 8 h et midi le Soleil grimpera de 25 GW et l’éolien de 15 GW de
vendredi à samedi, soit 4O GW au total… Et la consommation baisse… 46
GW, ce n’est plus possible, c’est plus que d’arrêter tout le reste… Or
il faut conserver de la réserve tournante : la preuve, il faudra
ré‑accélérer à fond la caisse les centrales pilotables le dimanche, car
le vent tombera.
Revenons au samedi ; il faudra donc arrêter des éoliennes et des
panneaux solaires, (et ce n’est pas aussi facile qu’on le pense,) en
même temps que baisser au minimum presque tout le parc nucléaire.
À l’inverse, le dimanche après-midi, il faudra réactiver
progressivement toutes les centrales pilotables précédemment en service,
dans un temps relativement court, tout en gardant l’équilibre du réseau
en tout point.
Or nous sommes en pleine perturbation météo, il y a de l’orage dans
certaines régions… Pas de chance, la foudre tombe sur un poste de
transformation de 400 000 V… (c’est peut-être ce qui est arrivé en
Angleterre). Ce serait déjà critique sur un réseau stable ; mais en
pleine montée ou descente rapide des centrales pilotables et de la
multitude de production diffuse, c’est la catastrophe. Pas de marge de
manœuvre. La fréquence monte ou baisse au-delà des normes ; les
protections automatiques des équipements de production réagissent.
Black out.
Or, tous les pays européens auront fait exactement la même chose que
nous en 2035 (parfois en pire, voir l’Espagne) en matière de mix
électrique et contrairement aux idées reçues, la météo est souvent la
même sur l’ensemble de l’Europe. La gestion des interconnections est
délicate, car transnationale (problèmes de langues, d’ego, ou même
financiers) alors que les réactions doivent être instantanées. La
probabilité est forte que tout le réseau européen s’écroule comme un
château de cartes.
Mais connecter ou déconnecter un équipement de production n’est jamais une opération simple. A fortiori en cas de black out.
La suite est un cauchemar. Les éoliennes devront se mettre illico en
sécurité par vent fort : dès qu’elles sont coupées du réseau, leurs
pales doivent se mettre en drapeau et freiner instantanément. Imaginons
que le dispositif soit fiable à 99,9 % ; cela vous paraît pas mal ? Eh
bien sur les 15 000 éoliennes en service en France, 15 verront leurs
pales partir en orbite. Espérons que personne ne sera à proximité.
Les panneaux solaires : le Soleil ne s’arrêtera pas de briller pour
autant là où il n’y a pas d’orage. Pour les multitudes d’onduleurs, y
compris chez les particuliers, en principe, cette situation de coupure
du réseau, avec risque de surchauffe, voire d’incendies… est prévue. En
effet, tous sont équipés de dispositifs qui ouvrent leur circuit en cas
de problèmes sur le réseau. (Car les volts restent, eux, localement, aux
bornes des panneaux, tant que le Soleil brille !) C’est indispensable
pour la sécurité de l’installation, du réseau, et surtout des personnes
appelées à travailler sur le réseau. Comment être sûr que ces centaines
de milliers de dispositifs vont tous parfaitement fonctionner ? Que
certains bricoleurs du dimanche n’ont pas voulu « améliorer » leur
installation ?
Les grosses centrales thermiques doivent réussir aussi instantanément
leur « îlotage », en cas de coupure du réseau, c’est-à-dire se mettre
en position de circuit fermé, n’alimentant que leurs propres besoins.
C’est toujours délicat. En cas d’échec, c’est l’arrêt complet, et de
longues heures pour redémarrer, et pour les centrales nucléaires, c’est
compter sur le diesel de secours pour assurer le refroidissement…
Coté utilisateurs, on peut avoir une idée à partir de la situation du
9 août en Angleterre : bouchons sur les routes en absence de
signalisation, des centaines de milliers de personnes coincées dans les
transports ferroviaires… des urgences sanitaires impuissantes…
Et les voitures électriques n’auront qu’un temps… celui de l’autonomie de leur batterie.
Pour les hôpitaux, ceux dont les diesel de secours seront un peu
lents à démarrer (il y en aura) déploreront des morts en salle
d’opération.
Le redémarrage sera laborieux, surtout parce qu’il faudra vérifier
que les milliers d’éoliennes et de panneaux solaires sont dans des
configurations de sécurité, pour eux et pour les réseaux. En outre, la
majorité des éoliennes et des panneaux solaires ne peuvent démarrer sans
être connectés à un réseau stable ; ils ne seront d’aucun secours pour
le redémarrage.
En réalité, personne n’est en mesure actuellement de prévoir ce qui
peut se passer dans un tel cas sur un réseau européen totalement à
majorité d’ENR aléatoires et diffuses. Il est facile de démontrer que
tous les récents incidents ou quasi incidents ayant survenu sur les
réseaux (Europe, Australie, New York…) ont des causes initiales diverses
: arrêt d’une grosse centrale, erreur de mesure, perte d’une ligne
haute tension… sans préciser que la situation a été rendue plus
difficile à gérer du fait de variations rapides de la puissance délivrée
par le vent et le Soleil.
D’ici 2035, la technologie peut évoluer… ou pas. Et 15 ans, c’est peu
pour l’investissement industriel. Et même dans ce cas, il faudra
inclure le coût des équipements supplémentaires rendus indispensables
dans le coût de l’électricité ENR.
Avant de développer les ENR intermittentes à hauteur de 90 GW, il faut d’urgence étudier vraiment,
à partir de situations concrètes,
les risques liés à la sécurité du réseau électrique car les études de
référence de RTE, utilisant des méthodes probabilistes, ne permettent
pas de statuer et elles ne tiennent pas compte de l’évolution des
réseaux interconnectés voisins.